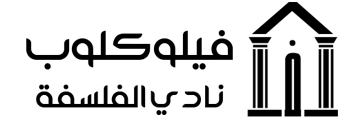Bonheur et liberté selon le stoïcisme
Bonheur et liberté selon le stoïcisme
- Copyright P. van den Bosch : La Philosophie et le Bonheur – Flammarion 1997
Le stoïcisme, ou l’amour du destin.
Ni la modération épicurienne des désirs, ni la suppression bouddhiste de tout désir n’ont paru être des sagesses satisfaisantes, capables de donner effectivement le bonheur. Il faut donc se mettre en quête d’une autre sagesse. Nous pouvons reprendre l’analyse, en partant de trois affirmations de base peu contestables : le bonheur, ce serait d’avoir tout ce que je désire ; la liberté, ce serait de faire tout ce que je veux ; l’homme, esclave de ses désirs, n’a ni bonheur, ni liberté. Cette dernière thèse a été suffisamment démontrée par Platon.
Folie des désirs
Mais pourquoi en va-t-il ainsi ? C’est qu’avoir tout ce que je désire, et faire tout ce que je veux, n’est pas en mon pouvoir. Obtenir tout cela ne dépend pas de moi, mais de circonstances extérieures, de la coopération d’autrui, de la chance, bref de l’ensemble de l’univers. Par exemple, être aimé ne se commande pas. Cela dépend des sentiments d’autrui. Je peux me mettre en frais pour séduire, mais je ne suis jamais assuré du résultat, ni de la naissance, ni de la durée d’un amour. Gagner un combat ne dépend pas davantage de ma seule décision : je peux m’entrainer le plus possible, mais la victoire dépendra de la force relative de l’adversaire. Faire fortune ne découle pas de mon simple désir. Je peux acheter un billet de loterie, mais je n’ai pas le pouvoir de faire en sorte qu’il soit gagnant. C’est le hasard qui en décidera. Je peux ouvrir un commerce, créer une entreprise, mais je me livre alors à tous les aléas de l’économie. En poursuivant tout cela, l’amour, la gloire, la richesse, le pouvoir, je désire des choses que ma volonté et mon pouvoir ne suffisent pas à m’octroyer, mais qui dépendent de l’ordre général de l’univers. C’est donc, semble-t-il, pure folie que d’y faire tenir mon bonheur. Sauf à être particulièrement favorisé par le sort, j’ai de fortes chances de ne pas tout obtenir, d’être dès lors frustré et malheureux. La sagesse serait donc de limiter mes désirs à ce qui dépend de moi, à ce que je suis certain de pouvoir posséder et conserver. C’est précisément ce que disent les penseurs stoïciens. Mais qu’est-ce qui dépend de moi ? Qu’est-ce qui est en mon pouvoir ?
Ce qui dépend de moi.
Mon pouvoir d’accomplir des actes est très limité, par les lois de la nature, ou les lois juridiques. Quand à mon pouvoir de faire réussir mes actions, il est quasiment nul, puisque cela dépend du concours du reste du monde, ou encore de la chance. En y réfléchissant bien, je ne suis pas absolument certain d’être encore vivant demain, ou tout à l’heure. Tant de choses peuvent arriver : un chauffard qui me renverse lorsque je traverse une rue, une fuite de gaz, une bombe qui explose, un caillot de sang qui obstrue une de mes artères, et je passe de vie à trépas, sans que j’aie nul pouvoir d’empêcher cela. Quand bien même je pourrais être fier de ma force physique, ou de mon autorité sur les autres hommes, je dois, si je veux être lucide, me montrer extrêmement modeste sur la faible étendue de mon pouvoir réel.
En revanche, il est une chose qui ne dépend que de moi, sur laquelle j’ai un pouvoir absolu : c’est ma volonté. Moi seul décide de ce que je veux. Par exemple, si je ne veux pas aller à un endroit, on peut m’y contraindre par la force, m’y emmener manu militari, mais on ne me fera pas vouloir y aller. On aura changé mon corps de place, mais on n’aura pas pu changer ma volonté. Certains hommes ont subi les plus longs emprisonnements, les pires tortures, mais rien n’a pu ébranler leur volonté. Je découvre, par cette réflexion, que je possède, comme chaque homme, une volonté absolument libre, ou encore un libre-arbitre, comme disent les philosophes. Je dispose donc d’un domaine de pouvoir et de liberté, qui est tout intérieur à moi-même.
Le secret du bonheur.
A partir de ce constat, je peux raisonner de la façon suivante :
— Certes, je n’ai pas le pouvoir de faire tout ce que je veux ;
— mais je peux choisir librement ce que je veux ;
— donc, je peux ne vouloir faire que ce que je peux faire, ou ce que je suis en train de faire (autrement dit, je peux limiter ma volonté à mon pouvoir) ;
— dès lors, je fais exactement ce que je veux ;
— donc, selon la définition, je suis libre, pleinement. La liberté intérieure de ma volonté assure, si j’en use bien, la liberté extérieure de tout mon être.
Je peux raisonner de même au sujet de ce que je possède :
— je n’ai, apparemment, pas tout ce que je veux, et j’en suis malheureux ;
— mais je peux ne vouloir que ce que j’ai ;
— dès lors j’ai tout ce que je veux ;
— donc je suis heureux.
Voilà donc le secret du bonheur et de la liberté. Il réside en peu de choses : savoir bien user de sa volonté, ne vouloir que ce que j’ai, et que ce qui m’arrive. Autrement dit, ne pas désirer ce qui excède mon pouvoir. Dire que ce secret est si simple, et que tant d’hommes passent à côté !
L’exaltation de la volonté, et l’erreur des Orientaux.
Nous constatons aussi que ce n’est pas une extinction de la volonté individuelle qui mène au bonheur, comme le pensent les bouddhistes, et presque tous les Orientaux, mais au contraire une apothéose de la volonté. Il nous faut avoir une grande force de volonté pour ne vouloir que ce qui convient. Il ne faut pas tuer la volonté individuelle, comme un principe de mal et de souffrance, il faut au contraire l’exalter, la renforcer, pour se dominer parfaitement. La maîtrise de soi ne passe pas par une extinction de soi, un renoncement à être, mais par une exaltation de sa force morale personnelle. L’erreur des Orientaux est de confondre deux choses différentes, le désir et la volonté. Plus exactement, ils ne discernent pas, dans ce qu’ils appréhendent comme désirs irrationnels, l’entité originale qu’est la volonté raisonnable. Ils ne perçoivent donc pas ce qui fait la vraie identité et la vraie grandeur de l’homme. Ils le ravalent au rang d’un pur être de désir, l’animal. C’est pourquoi ils ne voient pas d’objection à supposer qu’une même âme puisse s’incarner indifféremment dans un corps d’homme ou d’animal, au gré des métempsychoses. Les penseurs grecs, et parmi eux les stoïciens, ont identifié clairement le principe de l’humanité de l’homme : la possession d’une volonté raisonnable et libre.
La maîtrise de la pensée.
Dès lors, mon bonheur dépend uniquement de la pente que je donnerai à ma volonté, et à mes idées, à mes représentations des choses, qui sont essentiellement au pouvoir de ma volonté. C’est ce que nous dit Epictète :
“Souviens-toi que ce n’est ni celui qui te dit des injures, ni celui qui te frappe, qui t’outrage ; mais c’est l’opinion que tu as d’eux, et qui te les fait regarder comme des gens dont tu es outragé. Quand quelqu’un te chagrine ou t’irrite, sache que ce n’est pas cet homme-là qui t’irrite, mais ton opinion. Efforce-toi donc, avant tout, de ne pas te laisser emporter par ton imagination” (Manuel, Pensée 20).
En effet, si je suis vexé de l’insulte qu’un individu m’adresse, c’est que j’accorde une certaine valeur à son estime. Mais si je pense que ce n’est qu’un imbécile, ses propos ne m’atteignent plus. De même, s’il m’arrive un accident, et que j’en reste handicapé, si en outre je me pense victime d’un sort injuste, et que je désire échapper à cet état, j’en souffrirai. Mais si j’accepte mon état et ne désire rien d’autre, je ne serai pas malheureux. Cette maîtrise de ma volonté, de mes pensées, de mes désirs, est une règle de vie fondamentale à laquelle Epictète nous exhorte :
“Si quelqu’un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné ; mais de livrer toi-même ton âme au premier qui t’insulte en le laissant la troubler et la bouleverser, tu n’en as pas honte ? ” (Manuel, 28).
Aimer son destin.
Néanmoins, comment parvenir à maîtriser complètement mes désirs ? Ma volonté est-elle toujours assez puissante ? Là encore, une juste vision des choses, c’est-à-dire une bonne connaissance métaphysique du réel, peut nous aider. Les stoïciens affirment que tout ce qui arrive est nécessaire. Rien ne pouvait arriver autrement. En effet, chaque évènement est le fruit d’une longue série de causes. Et la relation de la cause à l’effet est nécessaire : un autre effet ne peut pas naître d’une même cause, ou d’un même ensemble de causes. Il ne sert donc à rien de désirer autre chose que ce qui advient, ou de se révolter contre ce qui est, car tout est nécessaire. On ne ferait que se rendre inutilement malheureux. Cette conception métaphysique juste de la nécessité qui règne dans toutes les choses du monde contribue à annuler mes désirs. “Quoi, tu voulais donc que ta femme vive toujours, qu’elle échappe aux lois de la nature ? Mais tu es fou ! ”, dit en substance le sage stoïcien à l’homme qui pleure la perte de sa femme bien-aimée. “C’est la Nature qui l’a faite et te l’a donnée, c’est maintenant la Nature qui te la reprend. Elle devait mourir un jour, comme tout être vivant. Et ce n’est pas toi, ni ton désir, qui en fixe l’heure”. Tel est le principe de la consolation : admettre ce qui nous arrive comme inéluctable, pour ne plus s’en affliger. Mais pour les stoïciens, la plupart des hommes sont comme des enfants ou des fous, puisqu’ils désirent sans cesse autre chose que ce qui est, et se rendent par eux-même malheureux. Epictète résume tout
cela ainsi :
“Il ne faut pas demander que les évènements arrivent comme tu le veux, mais il faut les vouloir comme ils arrivent ; ainsi ta vie sera heureuse” (Manuel, Pensée VIII).
C’est l’amour du destin, l’amor fati, auquel il faut parvenir pour être sage. Et Descartes reprit la sagesse stoïcienne en cette belle formule : “Il faut tâcher de changer ses désirs, plutôt que l’ordre du monde” (Discours de la méthode, II). Dit ainsi, cela semble en effet plus facile et plus raisonnable !
La Providence.
Les stoïciens allaient même encore plus loin dans cette réflexion sur l’ordre des choses. Ils ne s’en tinrent pas à cette simple conception de la nécessité absolue du rapport de cause à effet, idée qu’ont partagée tous les savants qui ont fondé la science moderne, en l’appelant dans leur jargon : “principe du déterminisme”. Ceci ne serait qu’une nécessité aveugle. Mais les stoïciens pensaient que la Nature est un être divin et intelligent, qui ne fait rien en vain. Tout est fait pour quelque chose, tout a un but, tout est finalisé. Cette idée, presque panthéiste, de la Nature, habite toujours l’esprit humain, et revient même très à la mode, à l’encontre des conceptions purement mécanistes de la science occidentale depuis quatre siècles. Le but ultime que poursuit la Nature, c’est évidemment le Bien. Le destin qui règne dans le monde est donc bon, il est une Providence. Mais ce Bien, c’est la vie et le Bien du Tout, de la Nature elle-même, non de chaque créature qui la compose. Chaque homme n’est qu’un rouage du grand mécanisme universel, et c’est par une folle présomption que chacun s’imagine être le centre du monde et voudrait que tout conspire à son bonheur. En revanche, cette idée que le monde est dirigé par la Providence, que chaque évènement concourt à un Bien pour le Tout, même si la petite partie que nous sommes ne l’aperçoit pas, cette idée est beaucoup plus puissante que celle de la simple nécessité pour incliner notre volonté à vouloir ce qui advient. Telle est précisément l’attitude du sage qui peut ainsi goûter le bonheur. Dès lors, chaque homme doit se persuader que la Providence lui a assigné un rôle à jouer sur la terre. Il ne doit pas désirer changer de rôle ou de condition, mais doit simplement s’efforcer de jouer correctement son rôle :
“Souviens-toi de ceci : tu joues, dans une pièce, le rôle que choisit le metteur en scène ; un rôle court ou long, selon ce qu’il a voulu. Veut-il que tu joues un mendiant ? Tu dois jouer ce rôle parfaitement, et de même si c’est un rôle de boiteux, un rôle d’homme politique ou de simple particulier ; Car ton travail à toi, c’est de bien jouer le rôle qui t’est confié ; mais, quant à choisir ce rôle, c’est le travail d’un autre. ” (Epictète, Manuel, 17).
Epictète et Marc-Aurèle.
De fait, la pensée stoïcienne, qui est née en Grèce trois siècles avant notre ère (avec, successivement, Zénon de Cittium, Cléanthe et Chrysippe), s’est répandue surtout dans l’Empire romain, dans toutes les classes de la société. Ses deux plus illustres représentants, Epictète (50-130) et Marc-Aurèle (121-180) illustrent tous deux cet idéal de résignation à son sort, malgré la dissemblance exemplaire de leur condition. En effet, Epictète était un esclave, et Marc-Aurèle, l’Empereur de Rome. Epictète acceptait parfaitement son sort, alors qu’il devait subir les brimades d’un maître cruel. Ce dernier finit cependant par l’affranchir. On peut le comprendre : ça devait être agaçant à la longue de fouetter un homme sans parvenir à altérer son bonheur, comme d’avoir un esclave dont la sagesse était d’un tel rayonnement qu’elle était célèbre dans l’Empire entier, et qui recevait plus de visites et d’honneurs que vous ! Au moins, nul ne pourra dire que ce philosophe ne mettait pas en pratique ces théories. D’ailleurs Epictète pensait que la philosophie s’enseigne plutôt par l’exemple de la vie du sage que par les grands discours. De fait, il n’écrivit aucun livre, et “ses” oeuvres, les Entretiens, sont dues à la plume d’un de ses disciples qui nota sur le vif les réponses qu’Epictète faisait aux questions de ses interlocuteurs. Le même disciple en tira un recueil de pensées (un “best of” ! ), le Manuel, dont j’ai cité quelques extraits. Quant à Marc-Aurèle, il était le maître d’un des plus grands empires de l’histoire, l’homme le plus puissant du monde en son temps. Mais croyez-vous qu’il éprouvait cette situation comme une sinécure ? Administrer ce gigantesque Empire était une rude tâche. Il lui fallait sans cesse partir guerroyer aux frontières, menacées de toutes part par les barbares et les Germains. Il lui fallait commander les hommes, mater les révoltes des soldats, vivre avec ses troupes en garnison dans la boue au bord du Danube, alors qu’il n’aimait que la poésie et les arts… Et lorsqu’il rentrait à Rome, il lui fallait encore régler mille problèmes, comme celui de ces chrétiens turbulents, qui ne voulaient pas reconnaître la divinité de l’Empereur et donc lui obéir, et qu’il fallait faire arrêter et jeter aux lions pour amuser le peuple. Quelle vie ! Marc-Aurèle trouvait la force de jouer son rôle dans la méditation philosophique. Il rédigea, au hasard des instants de répit, ses Pensées pour moi-même, comme un journal intime et métaphysique, trouvant dans une méditation sur la mort et sur l’ordre du monde un approfondissement hautain du sens du devoir :
“La durée de la vie humaine est un point ; la matière, un flux perpétuel ; la sensation, un phénomène obscur ; la réunion des parties du corps, une masse corruptible ; l’âme, un tourbillon ; le sort, une énigme ; la réputation, une chose sans jugement. Pour le dire en bref, du corps, tout est fleuve qui coule ; de l’âme, tout est songe et fumée ; la vie, c’est une guerre, une halte de voyageur ; la renommée posthume, c’est l’oubli. Qu’est-ce donc qui peut nous servir de guide ? une chose, et une seule, la philosophie. ” (Pensées, II, 17).
Les stoïciens pensent donc que l’homme peut goûter le bonheur quelles que soient sa condition et son environnement, par la seule maîtrise de sa volonté. “Le sage peut être heureux même dans le taureau de Phalaris” disaient-ils. Le taureau de Phalaris est un instrument de torture fort charmant, une sorte de grosse marmite dans laquelle on enfermait les suppliciés et en dessous de laquelle on allumait un feu pour les faire mijoter. Prétendre être heureux dans de telles conditions, il y a là quelque exagération ! Mais nous ne manquons pas de témoignages historiques du détachement avec lequel des sages stoïciens subissaient des sévices, d’où le sens de l’adjectif “stoïque” de nos jours.
Critique du stoïcisme.
Le stoïcisme est certes une exaltation de la volonté humaine, et non une destruction de ce qui fonde la dignité humaine, comme l’épicurisme et le bouddhisme. Mais c’est une bien étrange volonté qu’il prône : une volonté qui ne veut rien, ou au moins qui ne veut rien d’autre que ce qui est. Il s’agit d’une volonté creuse, vide, ou encore abstraite, comme le dit Hegel. Car l’essence de la volonté humaine n’est-elle pas de souhaiter ce qui n’est pas, de s’opposer à l’ordre parfois ingrat de la nature ? L’attitude stoïcienne exclut toute lutte pour la transformation et l’amélioration des choses, toute recherche du progrès technique, bref tout ce qui fait la spécificité et la grandeur de l’homme. Elle est toute de résignation, et finalement mutile l’homme presque autant que l’épicurisme et le bouddhisme. De nouveau, renoncer à être véritablement un homme, c’est un prix qu’il me semble inacceptable de payer, fût-ce pour le bonheur. Ce n’est donc pas encore une sagesse satisfaisante.
En outre, ce n’est pas non plus une sagesse efficace. En effet, les stoïciens affirment que je peux maîtriser mes désirs par ma seule volonté. Or je n’expérimente pas du tout cela. J’éprouve au contraire en moi un conflit entre mes désirs et ma volonté. Par exemple, ma volonté d’accomplir un travail auquel je me suis engagé par une promesse, peut être combattue par mon désir de m’amuser ou de paresser… C’est une expérience que chacun vit quotidiennement. Et l’issue de cette confrontation semble dépendre de la force relative des deux adversaires. C’est parfois le désir qui l’emporte, et non toujours la volonté raisonnable. Les stoïciens ne nous disent pas comment nous pouvons faire pour renforcer notre volonté. Ils semblent penser que la volonté résolue est toujours victorieuse, ce qui n’est pas le cas. Bref, même s’ils opèrent mieux que d’autres penseurs une distinction entre les deux, ils continuent de les confondre, en ce sens qu’ils absorbent trop les désirs dans la volonté, en les supposant en son pouvoir. Il nous faut donc découvrir une sagesse qui tienne mieux compte de la réalité de notre être, partagé entre ces deux dimensions.
Par ailleurs, cette insuffisance du stoïcisme renvoie à une difficulté interne à cette doctrine. En effet, elle consiste à penser que la Nature est tout entière ordonnée de façon bonne et raisonnable, puisque la volonté humaine doit accepter cet ordre. Dès lors, les besoins et désirs des hommes doivent être considérés comme naturellement bons. On peut l’affirmer pour certains, puisqu’ils assurent notre survie et notre participation à l’économie du monde. Mais comment alors peut-on désigner des désirs et des passions comme excessifs et mauvais ? Il y a là une contradiction flagrante, une incapacité à rendre compte du réel, qui est la marque d’une théorie insatisfaisante.